Parfois confondus avec les cancérigènes ou limités à leur impact sur la fertilité, les perturbateurs endocriniens couvrent une gamme bien plus large de pathologies. Explications.
1 - Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien?
«Si un poison traditionnel agit comme une bombe sur l’organisme, un
perturbateur endocrinien (ou PE) se rapproche plus d’une cyberattaque»,
explique Robert Barouki, biologiste et toxicologue à l’université
Paris-Descartes. Les PE viennent en effet perturber le système de
communication du corps humain, appelé système endocrinien, qui permet
aux organes de dialoguer entre eux via les hormones. Il existe
différents «modes de perturbation» qui viennent «brouiller» la
communication: un PE peut ressembler à une hormone et activer les mêmes
récepteurs ; il peut inversement inhiber ces mêmes récepteurs et
empêcher la diffusion du message hormonal ; il peut enfin perturber la
bonne synthèse des hormones ou des récepteurs qu’elles activent.
2 - Des effets très divers
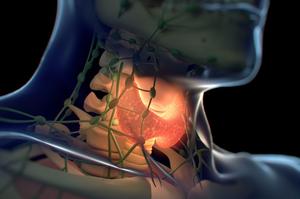
Comme les PE perturbent le système hormonal, ils sont souvent
assimilés aux seuls produits ayant des effets délétères sur la
fertilité, le développement et les organes reproducteurs.
«Historiquement, c’est comme ça qu’ils ont été découverts, par leurs
effets néfastes sur la taille du sexe des alligators ou le changement de
sexe de mollusques dans des lacs pollués», précise Robert Barouki.
«Mais les hormones interfèrent dans beaucoup d’autres domaines. On pense
aujourd’hui que les PE sont impliqués dans une très large gamme de
pathologies chroniques, telles que le diabète ou l’obésité. Ils ont
probablement un effet néfaste sur le développement cognitif, pourraient
favoriser le développement de certains cancers ou expliquer en partie la
recrudescence des allergies par les perturbations induites sur le
système immunitaire.»
3 - Une définition plus ou moins stricte
L’Organisation mondiale de la santé définit les PE comme «des
substances ou des mélanges de substances d’origines naturelles ou
artificielles étrangères à l’organismes qui peuvent altérer les
fonctions du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères
sur la santé d’un organisme intact ou de ses descendants».
«Peu de substances remplissent tous ces critères», prévient Robert
Barouki. «Il peut se passer des années, voire des décennies, pour
établir un lien de causalité définitif entre une perturbation du système
endocrinien et une pathologie donnée. Il existe en revanche des
centaines de molécules plus ou moins fortement suspectées. Lorsqu’on
observe une molécule se lier à un récepteur hormonal en laboratoire, on
peut raisonnablement s’inquiéter de sa possible toxicité. On parle alors
de perturbateur endocrinien potentiel.»
4 - Quelques exemples
Le bisphénol A est emblématique. Utilisé pour réaliser le vernis
intérieur des boîtes de conserves ou des canettes, il sert aussi à
fabriquer des plastiques durs et transparents… comme ceux des biberons.
C’est un perturbateur endocrinien reconnu en France, et depuis peu en
Europe. Toxique pour le système reproducteur, c’est un
oestrogéno-mimétique: il se fixe sur les mêmes récepteurs que les
oestrogènes, une hormone sexuelle femelle primaire.

Les PE potentiels ou avérés sont partout: phtalates dans les
plastiques mous, retardateurs de flammes bromés (dans tous les appareils
électroniques, les avions, etc), composés perfluorés des revêtements
anti-adhésifs, dioxines émises par la combustion des déchets ménagers
(en grande partie filtrées désormais), PCB utilisés comme isolants dans
les transformateurs (leur production a été arrêtée mais ils sont
extrêmement persistants dans la nature, si bien que l’on continue à être
exposés), pesticides organochlorés omniprésents, parabènes utilisés comme conservateurs en cosmétique,
etc. «Il existe aussi quelques composés naturels qui imitent les
oestrogènes dans certains végétaux comme le soja», ajoute Robert
Barouki. «Mais je ne suis pas vraiment convaincu qu’ils aient d’effets
toxiques ou nocifs pour la santé. On se pose des questions mais il n’y a
rien d’avéré.»
L’exposition n’est pas identique en fonction des molécules et de leur
usage. «Le bisphénol A utilisé dans un pare-choc de voiture, ce n’est
pas le même risque que celui dans le biberon d’un enfant», note le
toxicologue. «Il ne faut pas tout mélanger et faire preuve d’un peu de
bon sens.»
5 - Une temporalité complexe
Il peut s’écouler des années entre l’exposition à un perturbateur
endocrinien et le développement d’une maladie. «Une exposition pendant
le développement du fœtus peut induire une maladie des années plus
tard», rappelle Robert Barouki. «La plupart du temps, il faut une
exposition prolongée pour observer des effets néfastes. Dans certains
cas, c’est l’accumulation des PE dans les tissus qui déclenche
finalement une pathologie. Il faut peut-être plusieurs générations dans
certains cas. Cela rend les choses très compliquées à étudier.»
6 - La dose ne fait pas toujours le poison
Augmenter les concentrations d’un perturbateur endocrinien ne
renforce pas toujours l’effet. Dans certains cas, un PE est plus néfaste
à faible qu’à forte dose. Parfois, c’est à une dose intermédiaire que
l’effet est le plus prononcé. «Chaque cas est différent», rappelle
Robert Barouki. «Cela rend très difficile la définition d’un seuil
acceptable. Mais il ne faut pas généraliser. Il existe tout de même des
cas où la dose est clairement proportionnelle à l’effet. Il est alors
souhaitable de réduire l’exposition de la population à cette molécule
sans tergiverser.»
7 - Un effet cocktail compliqué à analyser
«Il existe 100.000 molécules artificielles utilisées dans
l’industrie, sans compter les molécules naturelles», rappelle Robert
Barouki. «On imagine le nombre astronomique d’associations potentielles
que cela induit. Il est impossible de tout tester.» L’action de certains
perturbateurs endocriniens vont s’ajouter.
D’autres vont s’annuler. Certains PE ne vont déclencher une pathologie
que s’ils sont associés entre eux… «Il ne faut toutefois pas renoncer
face à cette complexité. Il est raisonnable de penser que l’action de
deux PE qui agissent de la même manière vont s’ajouter. Cela peut
constituer un point de départ pour déterminer des seuils
intelligemment.»
Le Figaro santé, 04/07/2017.

Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire