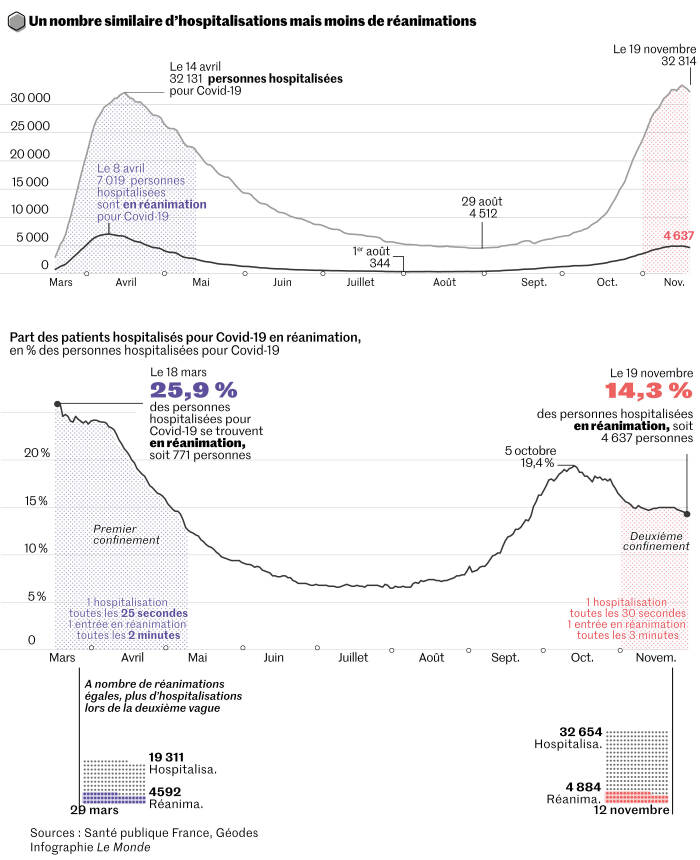Près de 2 milliards de personnes dans le
monde sont toujours privées d’installations sanitaires élémentaires,
alerte l’ONU à l’occasion de la Journée mondiale des toilettes.
En
pleine pandémie mondiale, les « gestes barrières » contre la
propagation du Covid-19 restent hors de portée d’une bonne partie de
l’humanité. Trois milliards de personnes ne peuvent se laver les mains
chez elles faute d’installation ; 1,4 milliard n’ont aucun accès ni à
l’eau ni au savon.
Dix ans
après avoir reconnu l’eau potable et l’assainissement comme un droit
humain fondamental, l’Organisation des Nations unies écrit dans un rapport publié jeudi 19 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale des toilettes, qu’« au rythme actuel des progrès, l’assainissement pour tous ne sera pas une réalité avant le vingt-deuxième siècle ». Un accès universel à l’eau et à l’hygiène en 2030, comme les Etats s’en sont pourtant fixé l’objectif, est encore très loin.
Selon
les chiffres de 2017 (les derniers actualisés), ce chantier reste
gigantesque. En effet, 2 milliards de personnes restent privées
d’installations sanitaires élémentaires (toilettes avec chasse d’eau,
fosses septiques, etc.) ; 4,2 milliards d’individus – près de deux
personnes sur trois dans le monde –, vivent sans pouvoir utiliser de
W.-C., latrines ou n’importe quel équipement relié à une forme de
traitement des déchets ; 673 millions défèquent encore en plein air.
Sous-financement chronique
D’autres indicateurs interpellent dans ce rapport qui se veut « un appel urgent à transformer l’assainissement pour améliorer la santé, l’environnement, les économies et les sociétés ».
Ainsi, dans le monde, 367 millions d’enfants fréquentent des écoles qui
n’ont pas de toilettes. Plus de 10 % des établissements de soins sont
dans le même cas, ce qui incite les femmes à ne pas venir accoucher dans
ces structures. Quant aux dizaines de millions de réfugiés et déplacés
de force, ils sont à peine un tiers (32 %) à disposer d’un
assainissement de base.
Les
conséquences pour la santé humaine et pour l’environnement sont
exorbitantes. Chaque année, 830 000 personnes meurent de maladies
hydriques qui pourraient être évitées comme le choléra, la diarrhée, la
dysenterie, l’hépatite A… La croissance démographique explique
partiellement ce manque de progrès nets. Mais si cette question
essentielle ne progresse que bien lentement, c’est aussi parce que le
secteur souffre de sous-financement chronique.
« Selon
la Banque mondiale, il faudrait débourser 115 milliards d’euros par an
entre 2015 et 2030 pour parvenir à un accès universel à l’eau et à
l’assainissement, autrement dit, il faudrait multiplier par trois les
investissements actuels », indique Céline Robert, responsable de la
division eau et assainissement à l’Agence française de développement
(AFD). Selon elle, il est difficile de mobiliser des investisseurs dans
ce domaine :
« L’eau est un secteur à risques faibles mais à rentabilité faible aussi et de très long terme. L’énergie par exemple est bien plus rentable financièrement. Pourtant
investir un euro dans l’eau a un effet d’entraînement sept fois
supérieur en développement, en maladies évitées, environnement
amélioré… »
Les
besoins sont énormes. L’AFD a par exemple participé au cofinancement
international de 16 millions d’euros de la station d’épuration de Beit
Lahiya, située au nord de la bande de Gaza. Celle-ci reçoit les eaux
usées de 250 000 habitants, soit trois fois sa capacité avant les
travaux d’agrandissement. Il lui est arrivé de déborder au point de
former un lac de 30 hectares, contaminant la nappe phréatique.
(...)
Source : Le Monde.fr, 19/11/2020.
Article intégral en ligne : https://www.lemonde.fr