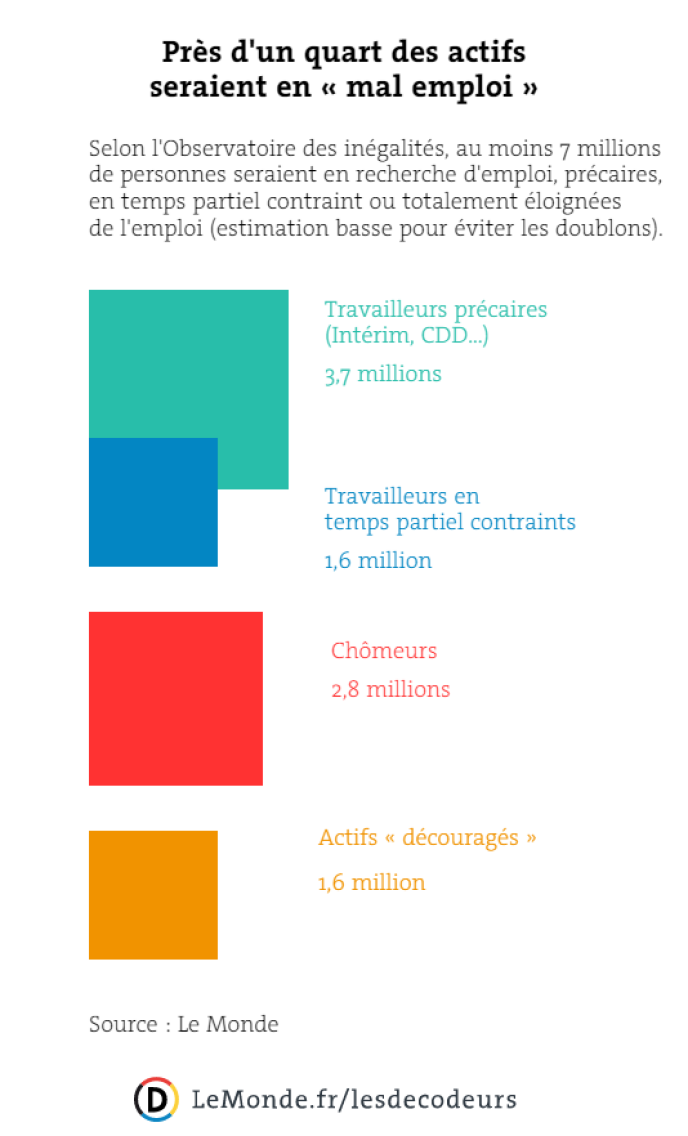Dans son avis définitif publié aujourd’hui, le comité scientifique consacré au cannabis médical propose une « expérimentation » pour cinq pathologies, dès 2020. Une avancée prudente, qui attend désormais le soutien du gouvernement. Pour l’heure, les malades, eux, souffrent et/ou se débrouillent. Toujours dans l’illégalité.
 |
| Production de cannabis thérapeutique sur le site européen du groupe
canadien Tilray, à Cantan hede, au Portugal. Patricia de Melo Moreira/AFP |
Le
gouvernement a sèchement fermé la porte, la semaine dernière, à une
légalisation du cannabis récréatif. En sera-t-il autrement pour sa
version thérapeutique, seule à même, semble-t-il, de soulager des
dizaines, voire des centaines de milliers de patients victimes de
douleurs chroniques insupportables ? Le comité d’experts mis en place
par l’Agence du médicament (ANSM) y est favorable, lui qui a été chargé,
à l’automne dernier, d’évaluer « la pertinence et la faisabilité de la
mise à disposition du cannabis thérapeutique en France ». Alors qu’une
dernière réunion était organisée mercredi avec les associations de
patients et les professionnels de santé, la structure pilotée par le
psychiatre et pharmacologue Nicolas Authier doit rendre aujourd’hui son
avis définitif. Son issue ne fait guère de doute. Le comité a déjà
validé, en décembre, la « pertinence » de la démarche. Et a livré ses
« préconisations », le 19 juin, sur la façon dont devrait se dérouler la
« mise à disposition » de ce produit sensible, déjà utilisé
clandestinement par de nombreux malades. En France, on estime qu’il y a
1,4 million d’usagers réguliers du cannabis, et 700 000 usagers
quotidiens, dont un tiers pour des raisons thérapeutiques.
D’après le plan du comité Authier, une expérimentation
serait menée « en situation réelle », pour cinq pathologies
spécifiques : les douleurs neuropathiques (résultant de lésions
nerveuses) non soulagées par d’autres thérapies, les épilepsies
résistantes aux traitements, les effets secondaires des chimiothérapies,
les soins palliatifs ainsi que les contractions musculaires
incontrôlées (spasticités) de la sclérose en plaques. « Des pathologies
choisies en fonction des données scientifiques disponibles et qui sont
en tête des prescriptions de cannabis dans le monde, là où cela a été
légalisé », précise Nicolas Authier. Différents dosages des deux
principes actifs majeurs du cannabis (le THC et le CBD) seraient
proposés, prescrits par les seuls médecins spécialistes des indications
choisies, s’ils sont « volontaires » pour participer et se former. Exit
le fameux joint – la combustion étant nocive pour la santé –, les
experts recommandent d’utiliser deux formes principales de cannabis :
celles à « effet immédiat » (huile et fleurs séchées pour inhalation) et
celles à « effet prolongé » (solutions buvables et capsules d’huile).
« Nous avions la crainte que les fleurs ne soient pas
autorisées. Aujourd’hui, le comité les promeut, c’est une bonne
nouvelle », a réagi Bertrand Lebeau, médecin addictologue qui soutient
le collectif Alternative pour le cannabis à visée thérapeutique (ACT).
Coprésident du collectif, Bertrand Rambaud, séropositif depuis
trente-cinq ans et utilisateur de cannabis depuis quinze, regrette, lui,
le cadre trop contraint de cette expérimentation. « Cinq pathologies
retenues, c’est bien peu quand l’Association internationale pour le
cannabis médical (IACM) en recense 41 pour lesquelles il est efficace.
De même, limiter la prescription aux seuls médecins spécialistes risque
de tuer dans l’œuf cette expérimentation. Ces médecins sont déjà
surbookés, ils ne prendront pas le temps de se former. » Conscient du
risque, Nicolas Authier défend ce qu’il présente comme une « mesure de
précaution ». « Beaucoup de médecins, et notamment les généralistes,
restent dubitatifs sur l’utilité du cannabis, pollués sans doute par
l’image négative qu’il conserve. L’expérimentation permettra de voir si
ce cadre est trop restrictif. »
Source : L'Humanite.fr, 27/06/2019.